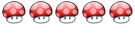LA CULTURE DE LA MORILLE
La morille est un champignon qui est très difficile à cultiver.
Il existe 4 méthodes :
1 Essais culturaux, méthode empirique
2 Essais en laboratoire, in vitro
3 L'approche rétrograde
4 Essais en milieu naturel d'une culture de mycelium avec suivi continu
protocole de culture mis en place par Gary Mills (methode 2)
1 La cueillette des morilles
Vous devez commencer par trouver des morilles lorsque la saison commence, puis les mettre au réfrigérateur (3°-4°) en attendant de les utiliser (rapidement après la cueillette) pour faire votre essai de culture.
2 Préparation du plan
Nettoyez votre plan de travail avec un spray d’eau de Javel diluée (5%) et respectez au maximum les consignes de stérilité.
3 Récupération des spores de la morille
Percez le pied de la morille avec un trombone (stérilisé à la flamme),
puis suspendez votre morille, chapeau vers le bas, au dessus d’une gélose à l’agar-agar. Il est préférable d’utiliser le milieu PDYA pour le développement du mycélium de morille. Vous pouvez taper délicatement le pied de la morille avec votre doigt pour faciliter la tombée des spores. Vous pouvez aussi essayer de cloner un morceau de tissu de la morille pour produire votre mycélium.
4 Incubation de la gélose
Placez ensuite votre gélose nutritive dans votre incubateur à une température comprise entre 12° et 26°. Après quelques heures ou quelques jours, les spores de morille vont germées et du mycélium va commencer à se développer. Si autre chose que du mycélium blanc à brun foncé pousse sur votre gélose vous devrez effectuer une purification de la culture (futur article)
5 Transfert du mycélium
Lorsque votre gélose nutritive est complétement colonisée, vous pouvez vous en servir pour inoculer une autre gélose ou un substrat à base de céréales: graines de colza, de chanvre ou du riz, blé, seigle ou graines de gazon
6 Préparation du substrat
Déposez vos céréales dans un récipient et recouvrez les d’eau puis patientez 24 heures.Egouttez soigneusement les graines et mélangez les avec du terreau, à raison d’1 part de terreau pour 5 parts de céréales.
Déposez ensuite ce mélange dans un pot en verre stérilisable équipé d’un couvercle filtrant.
7 Stérilisation du substrat
Stérilisez votre substrat pendant 1h15.
8 Inoculation du substrat
Servez vous de votre mycélium de morille sur gélose pour inoculer votre substrat.
9 Incubation du substrat
culture de la morille
Après l’inoculation, mélangez bien votre substrat et placez le dans votre incubateur à une température comprise entre 20° et 22° pendant 4 à 6 semaines. Si tout se passe bien et qu’un mycélium blanc colonise le substrat, des petites sclérotes (amas de mycélium) de couleur blanche à rouille devraient se former à partir de la 5eme semaine. Lorsque les sclérotes sont visibles dans les bocaux, préparez des barquettes propres pour recevoir le substrat de fruitaison qui devra être placé dans votre chambre de culture afin de contrôler la température, l’hygrométrie, la lumière et le renouvellement d’air sain.
10 Préparation du substrat de fruitaison
Réalisez un mélange constitué de: 20% de sable, 30% de terreau, 40% de copeaux de feuillus (frêne, chêne, érable, hêtre, orme, pommier, etc), 5% de son de riz, 2,5% de tourteau de soja, 2,5% de tourbe (sphaigne) et un peu de chaux pour que le pH du substrat soit compris entre 7,1 et 7,3
11 Préparation de deux bacs pour le substrat de fruitaison
Remplir une 1ere barquette (en aluminium ou plastique, stérilisable, percée de plusieurs trous dans le fond) sur environ 5 cm de hauteur avec le substrat de fruitaison, arrosez de manière à saturer le substrat d’eau puis laissez égoutter.
Dans le 2eme bac, mettez une couche de céréales détrempés sur environ 2cm. Mettez le 1er bac SUR le 2eme bac et placez les dans un sac de cuisson en plastique équipé d’une aération filtrée; stérilisez le tout pendant au moins 1 heure.
12 Inoculation et incubation du substrat de fruitaison
Une fois les barquettes refroidies, ouvrez le sac de cuisson sur votre plan de travail propre en respectant les consignes de stérilité.
Mélangez 250ml du substrat préparé (partie 2/3) à chaque barquette de substrat de fruitaison à l’aide d’une cuillère stérilisée à la flamme. (cette mesure est valable pour des bacs de 24x24x6 cm, adaptez le dosage à la dimension de vos barquettes). Refermez le sac et placez le dans votre incubateur à une température comprise entre 18° et 21°C pendant 4 à 6 semaines. L’humidité devra dépasser 90%, le taux de CO2 être comprit entre 6000 et 9000 ppm sans aucune ventilation.
13 Apparition des sclérotes
Après 4 à 6 semaines, la surface du substrat devrait être recouverte de sclérotes. Les sclérotes sont le secret de la culture des morilles. Ce sont les « graines » de vos champignons. Vous pouvez conserver vos sclérotes non utilisées au frigo (3-4°C) pendant un an.
Un choc thermique (futur article) doit être réalisé. Une fois les sclérotes apparues, enlevez la barquette inférieure (contenant les céréales) et refermez le sac. Placez le au frigo (3-4°C) pendant deux semaines. Ensuite, sortez la barquette du sac et mettez la dans votre chambre de fruitaison. Saturez lentement le substrat d’eau (stérilisée) à 20°C puis après 12 à 16 heures videz tout l’excédent.
14 Couche de gobetage (optionelle)
Vous pouvez utiliser une couche de gobetage d’un cm puis placer le substrat à une température comprise entre 18° et 21°. Le mycélium de la morille mettra entre 7 à 10 jours à percer la couche de gobetage.
15 Pousse de la morille
Les primordias (ébauche de champignons) devraient faire leur apparition au bout de 3 à 7 jours. Conditions de culture jusqu’à l’apparition des primordias:
Humidité substrat: 60%
Humitité relative de l’air : 95-100%
Température : 21-23°C
Renouvellement de l’air : 6-8/H
Cycle lumineux: 12H/J
CO2 : >900ppm
Maintenir ensuite ces conditions de culture:
Humidité substrat: 50%
Humitité relative de l’air : 85-95%
Température : 23-25°C
Renouvellement de l’air : 6-8/H
Cycle lumineux: 12H/J
CO2 : >900ppm
Autres méthodes : sur terrain sauvage
le terrain
Le meilleur terrain est celui où l'on a récemment trouvé des morilles ou, si on ne veut pas mélanger les expériences, un terrain assez proche et présentant les mêmes caractéristiques mais non encore reconnu comme productif. Il est plus prudent, si on le peut, de cultiver l' espèce indigène bien que ce ne soit pas indispensable. Non loin d' une station de rotunda j' ai obtenu vulgaris, crassipes et même costata (espèce semble -t-il assez peu éxigeante, mais souvent à proximité d'un ancien feu, de cendres ).
Profil du sol:
Une pente légère semble favorable. Elle permet un bon écoulement de l'eau tout en prolongeant la présence d'humidité dans la partie basse. L'eau de pluie doit pouvoir pénètrer et demeurer quelque temps mais il faut un bon drainage.
De petites cuvettes, sortes de cratères, disposées sur une pente de 2 à 10% , favorisent des noyades temporaires avec un bon ressuyage sans dispersion excessive du mycélium.
Un système de terrasses? ou de "tôle ondulée ?
Exposition :
Il faut trouver le bon ensoleillement. Un peu de soleil direct est nécessaire. Les sites trop ombragés ou trop frais sont à écarter. ll faut privilégier les sites qui se réchauffent facilement au printemps, ni noyés ni trop rapidement désséchés et qui conservent une bonne humidité atmosphérique. ce sont souvent des endroits abrités mais bien orientés.
Une lisière humide, aérée, bien abritée des vents secs (d'Est en Aquitaine) et suffisamment ensoleillée convient souvent.
Choisissez votre emplacement en mars ou septembre, époques de l'année où certains espaces d'ombrage et d'ensoleillement changent très rapidement et pour plusieurs mois. Peut -être est-il intéressant de repérer les espaces ombragés pendant tout l'hiver qui recoivent leur premier soleil début mars.
Nature et composition du sol: (très sommairement)
Toutes les variétés préfèrent une terre peu lourde, plutôt perméable mais avec une bonne capacité à retenir l'humidité (un peu d'argile peut-être).
Il faut éviter un excès d'humus. Une base de terre calcaire semble indiquée pour vulgaris, rotunda, crassipes , du sable pour spongiola; probablement une couverture acide pour conica.
ll faut éliminer l'excès d'herbes et de feuilles. Une bordure de chemin de terre, une lisière avec de la terre apparente et une légère couche de feuilles sèches sont favorables. Une plate-bande retournée, à mi-ombre avec une légère couverture de feuilles fera aussi l'affaire.
PRINCIPE
" Dynamique du mycelium"
Abordant le cycle de la morille nous avons retenu le scenario suivant:
Le carpophore ne fructifie pas sur le mycélium de l'année précédente mais sur un mycélium nouveau et très récent, dernier avatar d'un cycle conidien, développé en toute fin d'hiver ou même en début de printemps. Le mycélium conidien, semi nomade, se perpétue, se reproduit de façon aléatoire plusieurs fois dans l' année quand des conditions favorables se présentent. Tant mieux s'il est suffisamment abondant et développé lorsqu'arrive l'époque de la fructification. Sinon....
L'idée vient naturellement d'aider la nature en multipliant ce mycélium pour qu'il soit prêt en abondance quand commence la période de fructification.
Or il se trouve que cette multiplication est aisée à obtenir, peut se faire toute l'année hors du site de culture envisagé.
On pourra ainsi disposer de quantités importantes en temps voulu et cette question de calendrier a sans doute beaucoup d'importance. La fructification se produit dans le bon créneau climatique. l' expérience nous apprend que ce créneau est court et que le mycélium doit être "à l'heure". Il ne s'agit pas de rater le coche. les aléas climatiques n'offrent pas tous les ans une "fenêtre de tir" suffisante pour qu' un mycélium étique ou mal réveillé ait une bonne chance de produire des carpophores. Il ne faut pas manquer l'occasion.
"Après l'heure ce n'est plus l'heure", "avant l'heure ce n'est pas l'heure"; Mais être parfaitement prêt "un peu avant l'heure" c'est plus prudent.
Chacun pressent qu'il ne doit pas être très difficile d'obtenir un mycélium un peu en avance sur la saison, soit par un léger forçage, soit par l'utilisation de produits végétaux qui favorisent le déclanchement de son développement précoce.
Affinons: Nous avons tout intérêt à dissocier l'activité " production de mycélium" de l'actitvité " production de carpophore". Cela ne contredit pas notre souci de culture naturelle.(tout pépiniériste fait ce genre de distinction et fait germer des graines avant de transplanter ).
Nous pourrons ainsi frapper tôt, frapper fort, frapper vite et juste. Car la campagne sera brève, comme une guerre éclair, avec comme objectifs: occuper la totalité du terrain avant les concurrents, en masse surabondante pour saturer les prédateurs, accaparer avant tout autre organisme la totalité des ressources utiles. Telles sera le rôle de ce mycélium bien préparé et dynamique.
ETAPES DE CULTURE
1. Préparer le mycélium
Le mycélium a été obtenu soit sous forme solide soit sous forme liquide ( Voir culture du mycélium). La forme liquide récente est préférable. Elle est plus "plastique" et plus "active". On aura donc intérêt à forcer les cadences de production de mycélium en février.
On remarquera que les oïdies et les conidies du mycélium de morille (toutes variétés confondues) germent à une température supérieure à + 5°c , en génèral.
Il faut maintenant réveiller le mycélium:
Deux ou trois jours avant de disperser le mycélium sur le terrain on le mélangera dans un récipient à du jus ou de la compote de pomme et on placera le tout dans un local tempéré (10-15°C). Mettre une une bonne mesure de mycélium.
Après ce délai de deux jours, ou davantage, on préparera le liquide à répandre en quantité dans de grands récipients:
A titre indicatif:
Pour 10 litres prévoir 4 kg de compote, 5 litres d'eau, une poignée de chaux, une poignée de terre argilo-calcaire, une poignée de cendre de bois et le mycélium déjà préparé. Mélanger le tout de façon très homogène.
2. Le répartir sur le terrain
Bien répartir le liquide, par le moyen qui vous paraîtra le plus adapté, de façon régulière sur toute la surface d'un sol bien humide, après une bonne pluie, par exemple; 2 litres par m² environ suffisent.
Pour ménager des endroits où le mycélium pourra trouver un bon ancrage on peut, auparavant, faire de petites entailles dans le sol avec un outil quelconque.(2 à 4 cm)
On peut aussi envisager d' utiliser de grands volumes de liquide et de noyer le terrain , avec une proportion de compote plus faible (10 % peut-être). Cela apporterait probabement encore suffisamment de principes nutritifs.
3. Choisir la date
Il est inutile de répandre trop tôt le mycélium sur l'emplacement de culture choisi. Cela ne servirait qu'à nourrir les fourmis, les nématodes et autres "animalcules" qui en sont friands. Des températures trop fraîches ne sont pas favorables à son développement rapide. Les pluies pourraient le disperser. On attendra la fin de l'hiver.Toutes mes expériences confirment que seules les mises en place tardives du mycélium donnent de bons résultats.
Le moment le plus favorable me paraît être : lorsque la température se radoucit mais qu'il y a encore des gelées nocturnes, entre le 20 février et le 10 mars, par une journée plutôt douce, après une bonne pluie et s'il est prévu un ou deux jours doux et sans précipitations ( et, mieux encore, sans vent). Ici, il faut faire appel à un "devin-météorologue"
Les conditions climatiques doivent permettre à ce mycélium de se développer et de s'implanter rapidement pour occuper le terrain (voir chap: principe). Ces conditions climatiques varient considérablement d'une année sur l'autre. Certaines années on aura intérêt à répandre le mycélium plus tôt, d'autres plus tard. Il faut être un peu prévisionniste. L'expérience m'incite à croire que le choix le plus adapté est une dispersion tardive (1er au 10 mars), sur le terrain, d'un mycélium obtenu récemment en milieu frais. On peut répartir les risques en échelonant l'implantation du mycélium sur deux ou trois dates, par exemple 20 février, 1er et 10 mars. Je testerai même la date du 15 mars. Les implantations précoces (avant février) ont rarement donné des résultats.
4. recouvrir
Une fois ces opérations réalisées il convient de couvrir le terrain d'une légère couche de feuilles, bien répartie sur deux à quatre centimètres d'épaisseur environ. Comme le précise le baron d'Yvoire, il faut proscrire les feuiles trop lourdes ou volumineuses( comme celles du platane et bien d'autres). Exclure aussi celles qui se décomposent trop rapidement (tilleul par exemple) ou celles qui deviennent molles et collantes sous l'effet de la pluie. Préférer des feuilles sèches d'orme, de frêne, de chêne, de marronnier,de charme ...etc. On peut les conserver dès l'automne dans un endroit à l'abri de la pluie et de la fermentation.
Elles favorisent, au niveau du sol, un climat abrité des excès de vent et des précipitations directes tout en permettant une certaine aération. Elles laissent pénétrer l'eau et, en partie, la lumière. Elles maintiennent l'humidité.
Cette couche de feuilles doit être recouverte de brindilles légères mais d'un poids suffisant pour résister au vent.
Il faut enlever une partie de ces feuilles avec délicatesse une ou deux semaines avant la date prévue de l'apparition des premières morilles (espérées). Peut être pourrait-on remplacer ces feuilles par une autre couverture, un autre matériau. Mais quel en serait l'intérêt...( surtout esthétique)?
5. Arroser régulièrement
En tout temps, qu'il fasse chaud ou froid et même s'il gèle, arroser le terrain une ou deux fois par jour. Par temps ordinaire de saison un bref arrosage en pluie fine, une à deux minutes environ, sur toute la surface utile, suffira. Cela permettra d'augmenter l'humidité ambiante. Mais si le temps est sec augmenter nettement les doses. Le délavage du substrat est probablement un facteur favorable à la formation des tissus ascogènes et à la formation des ascospores.
6 Surveiller
- D'abord le climat et la végétation
Il faudrait affiner suivant les variétés de morille. Cette liste concerne surtout la variété vulgaris , morille commune, plutôt précoce.
- Ensuite .......... les limaces
Déjà, elles attaquent!!!
Malgré le respect qui est dû à ces animaux, je répands quelques granulés çà et là. A eux de juger s'ils veulent ou ne veulent pas en absorber.
http://www.cultiverlamorille.izihost.co ... il_034.htm
http://www.natures-paul-keirn.com/artic ... uu6wrmPKUk
http://centre.france3.fr/2013/04/11/des ... 32691.html
http://www.over-blog.com/com-1317368589 ... s_bio.html
http://www.sudouest.fr/2013/04/17/moril ... 4-1851.php
https://fr-fr.facebook.com/FranceMorillesSas
http://www.morilles-extra.com/la-cultur ... rille.html
http://philippecagnac.20six.fr/philippe ... rt/1442625
http://sciences.gloubik.info/spip.php?article1176
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/ffa5c4e ... ubsistance